La bio du pain
Publié le 4 novembre 2010 par Monsieur Septime
Le « Dictionnaire universel du pain » est un travail monumental, entrepris sous la direction de Jean-Philippe de Tonnac.


Essayiste et journaliste Jean-Philippe de Tonnac a exploré des domaines aussi divers et variés que l’anorexie, la vie de Bob Marley ou encore les Cathares. Nous étions donc curieux de voir le résultat de ce travail. Rien à redire, le directeur de ce Dictionnaire a frappé fort et pour longtemps. Il a même passé son CAP de boulangerie en 2007 pour mieux se mettre dans la peau d’un expert de la mie de pain et de la croûte qui croustille. Symbole multiforme et produit alimentaire ô combien culturel, le pain, intéresse peu curieusement chercheurs en sciences humaines et intellectuels, à l’exception notable et pionnière de l’historien américain Steven Laurence Kaplan qui préface l’ouvrage. Les deux compères avaient déjà collaboré lors d’un livre entretien un peu trop fouillis, « La France et son pain – Histoire d’une passion », édité chez Albin Michel en mai 2010.
Après une brève chronologie mondiale du pain, le Dictionnaire rentre dans le vif du sujet en proposant 1500 entrées. De « abaisse » à « zymase » le lecteur peut se perdre au fil de sa lecture, sautant au hasard d’une définition à une autre ou suivre les 18 itinéraires thématiques proposés. Ils sont à la fois clef et grille de culture appelant à la connaissance et au partage du savoir. Itinéraires qui peuvent être liés à la physiologie de la plante comme celui concernant « l’anatomie du grain de blé » et « les céréales », à l’histoire avec « Mythologie, croyances ou religion », ou encore aux symboles liés au pain avec « Approches symboliques ». Ce dernier parcours offre la possibilité au lecteur de s’interroger sur les bases du fermentescible de notre civilisation ou encore sur la symbolique de la fertilité et de la fécondité liée à la pâte à pain.
Parmi les contributeurs on compte des historiens comme Jean-Jacques Glassner assyriologue et directeur de recherche au CNRS ou Philippe Martin spécialiste de l’histoire des dévotions, des anthropologues, tels que Esther Katz et Marie-Claude Mahias enseignante à l’EHESS et directrice de recherche au CNRS, des spécialistes de l’histoire des religions représentés par Pierre-Antoine Berheim spécialiste de l’origine du christianisme et Julien Darmon qui enseigne l’histoire et la méthodologie des littératures rabbiniques. Mettent également la main à la pâte érudite, des passionnés de tous poils. Les gourmets seront ravis puisque il a été demandé aux vingt-neuf meilleurs artisans boulangers à travers le monde de livrer quelques recettes : le pain Poilâne aux fines herbes côtoie ainsi le t’anta wawas péruvien sans oublier le tirnaki ekmec turc au yaourt. Un ouvrage magique qui vient combler un manque et qui ravira aussi bien l’amateur gastronome que le thésard en SHS.
2 commentaires sur “La bio du pain”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

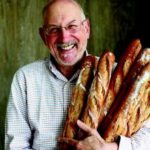
La bio du pain
Sujet autant intéressant qu’enrichissant. Et plutôt nourrissant pour l’esprit, histoire de rester en phase avec le sujet abordé…
Tout compte fait, la symbolique du pain s’inscrit dans une continuité historique, dont la thématique renvoie à des problématiques qui ne sont pas seulement diététiques ou économiques, mais également sociologiques et politiques, voire idéologiques par certains aspects.
Plus qu’un « simple aliment de base », le pain se révèle être un « support de mémoire collective et de cohésion sociale ». Ce qui en fait par excellence cette vitrine, autant transparente que troublante, à travers laquelle se déploient bien des enjeux et défis inhérents à la condition humaine.
Je me garderai d’en dire davantage, quoiqu’il y ait à en redire…
Clara ODIKA-WIEDEMANN, enseignante (New York)
La bio du pain
A l’image du vin, le pain a ceci de particulier, donc d’intéressant, qu’il revêt des significations qui vont bien au-delà de son usage quotidien. De ce point de vue, le pain s’est toujours imposé comme « étalon de mesure » dans ce qu’il y a de plus fiable et viable. Au point de devenir un baromètre des pressions sociales (« émeutes de la faim ») et environnementales (hausse des prix en cas de sécheresse), ainsi qu’un indicateur économique (son prix et sa disponibilité reflètent le pouvoir d’achat d’une population) et un marqueur de gouvernance (politique agricole adaptée ou pas).
En résumé, le pain ne nourrit pas seulement les corps: il alimente aussi notre imaginaire collectif. En d’autres termes, le pain nourrit l’homme parce qu’il nourrit son âme. En quoi il constitue, au même titre que l’art, l’un des substrats nourriciers de notre inconscient collectif…
Michel ODIKA, médecin (New York)