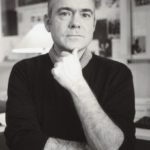Christophe Boltanski, grand reporter de la mondialisation
Publié le 10 janvier 2012 par Guillaume Jan
A travers une enquête minutieuse et internationale, il a remonté les filières de la cassitérite, principal composant de l’étain, l’un des minerais les plus disputés pour les mobiles et les ordinateurs
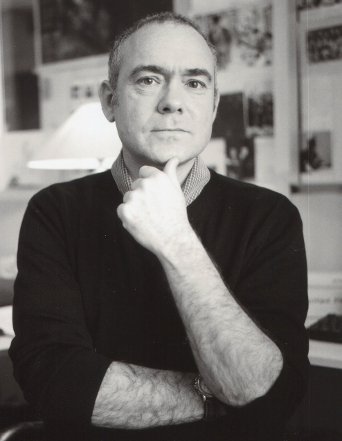
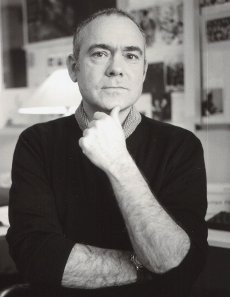
« Dans la région des Grands Lacs, la guerre est la continuation de l’économie par d’autres moyens »
En 2008, le journaliste bientôt quinquagénaire part couvrir la énième guerre qui secoue le Kivu, région réputée pour son sous-sol truffé de richesses naturelles mais déstabilisée par quinze ans de conflits sporadiques et de rebellions incontrôlées. Les troubles datent du génocide rwandais de 1994, quand les auteurs des massacres passent en République démocratique du Congo, en fuite désorganisée, rapidement transformée en razzia sur la population et le sous-sol. Sur place, le reporter réalise à quel point ce conflit est généré par cette terre riche en minerais rares : plusieurs armées rebelles, servant les intérêts des Etats voisins ou de grands groupes occidentaux, sont en manœuvres perpétuelles dans la région depuis le milieu des années 1990. « Dans la région des Grands Lacs, la guerre est la continuation de l’économie par d’autres moyens, écrit-il dans sa fascinante enquête. (…) L’argent tiré du sous-sol sert à acheter des armes, à financer des milices, donc à prolonger le conflit (…) De l’instabilité du Congo dépend la stabilité de la sous-région. »
L’ONU, embourbée sur place dans une opération aussi coûteuse qu’inefficace, dit la même chose : « Des groupes criminels associés aux armées rwandaises, ougandaises, zimbabwéenne et congolaise ont mis sur pied une économie de guerre axée sur l’exploitation des minéraux. » Effaré par ce scandale humanitaire, Boltanski décide d’explorer le sujet pour déterminer combien cette guerre de quinze ans, qui paraît si lointaine aux yeux des Occidentaux, est liée à leur confort technologique et à leur image de la modernité. En particulier, il pointe un minerai-clé dans la poursuite de la guerre : la cassitérite.
» On nous avait annoncé l’entrée dans l’ère du virtuel, l’industrie minière etait devenue synonyme de charbon, de saleté, de XIXe siècle. Or nous sommes plus que jamais dépendant de ces matières premières »
C’est le principal composant de l’étain. Et l’étain, facile à manipuler et à souder, excellent conducteur, est devenu un métal indispensable à la composition des innombrables objets électroniques dont les circuits imprimés rendent notre quotidien si confortable.
« PC, MP3, cellulaires, PlayStation, caméra digitale, décodeurs, radio, hi-fi, scanners, imprimantes, voitures, avion, tout ce qui comporte d’électronique, toute notre modernité en contient une trace, énumère Christophe Boltanski. On nous avait annoncé l’entrée dans l’ère du virtuel, l’industrie minière etait devenue synonyme de charbon, de saleté, de XIXe siècle. Or nous sommes plus que jamais dépendant de ces matières premières. ».
Dans les mines du Kivu, il raconte le quotidien infernal des creuseurs, les tunnels toujours plus longs, les sacs de cinquante kilos portés sur les épaules, les risques insensés qu’ils prennent pour gagner quelques francs congolais – ou rien du tout, parfois, quand leur exploitation est pillée par les hommes en armes ou que ces « esclaves du monde moderne » doivent trimer gratuitement sur les nouveaux filons, pas encore rentables. « Les gisements de cassitérite sont peu riches, ils ne se prêtent pas à la mécanisation. Cette main-d’œuvre artisanale semble être la seule manière de l’extraire. »
Patiemment, le journaliste remonte la filière. Il voyage à bord des bimoteurs interlopes qui acheminent le minerai à Goma, la grande ville du Kivu, et va fouiner du côté des comptoirs. Il pose partout une question simple : où part cette cassitérite ? Ses interlocuteurs le prennent d’abord pour un marchand déguisé : « Ils pensaient que j’étais là pour monter des business. Très peu de journalistes sont allés enquêter sur place, la mine ne figure sur aucune carte. » La réponse finit par arriver : la cassitérite est exportée par containers en Malaisie. Il accompagne un convoi terrestre jusqu’à Dar-es-Salam, le principal port de Tanzanie, sur l’Océan Indien. Sa traque ne fait que commencer. « Jusqu’au mois d’avril 2011, je n’avais aucune idée d’où partait le minerai. » Achetée 3 dollars le kilo à la mine, la cassitérite est vendue 6 dollars à Goma, 10 à Kigali. Une fois transformée en étain, elle est côtée à 28,5 dollars le kilo au London Metal Exchange. Au bout de son enquête, qui lui a coûté la bagatelle de 10 000 euros, Boltanski se rend au Ghana, dans les dépotoirs pour déchets informatiques de l’Europe ou des Etats-Unis. La multiplication des intermédiaires le fascine : « Ce morcellement est vertigineux. C’est une caractéristique du monde dans lequel on vit, le système économique est conçu de façon à ce que personne ne soit responsable de rien. Le rêve des entreprises contemporaines, c’est de n’être qu’une marque détachée de toute considération matérielle, ce que disait déjà Naomi Klein, dans No Logo. » Pour mener à bien son enquête, il alterne les séjours à l’étranger, en Afrique ou en Asie, avec des interviews dans les sphères lissées du pouvoir politique ou économique, cherchant des porte-paroles pour raconter le parcours de ce silencieux caillou. Il tisse en même temps une trame, un suspense de polar – c’est là une des réussite de ce roman-vrai de 344 pages.
« L’époque s’est mondialisée. Les relations se sont complexifiées. Albert Londres n’aurait sans doute pas suivi ce caillou jusqu’en Malaisie »
« J’aurais pu écrire un livre théorique sur la mondialisation, mais ça ne m’intéressait pas. Je préférais incarner une réalité, plutôt complexe, à travers l’exemple de la cassitérite. » Pour rendre son sujet compréhensible, le grand reporter fait appel à l’histoire, à la sociologie, aux tactiques de communication des grandes entreprises, à l’économie. « J’ai pris beaucoup de notes, raconte Christophe Boltanski. Je les saisissais le soir sur mon ordinateur, pour tenter de mieux dénouer le fil ». Diplômé du Centre de formation des journalistes en 1987, le fils du sociologue Luc Boltanski (et neveu du plasticien Christian Boltanski) s’est vite intéressé au reportage. Il travaille quelques mois au Nouvel Observateur (déjà), avant de faire son service militaire en coopération en Egypte, puis d’être embauché, pendant dix-sept ans, au quotidien Libération. Il retourne au Nouvel Observateur après le départ de Serge July. « J’ai aujourd’hui la chance de travailler dans un hebdomadaire où l’on a du temps pour travailler sur des enquêtes au long cours. Quand j’étais à Libération, il nous fallait constamment raccourcir nos articles. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution pour que la presse papier survive à Internet. A mon avis, elle aurait plutôt intérêt à jouer sur des formats longs. »
Une certitude : « Le métier de journaliste n’a pas vraiment changé depuis Albert Londres, on se rend sur place, on interroge des gens, on prend des notes. Seulement, l’époque s’est mondialisée. Les relations se sont complexifiées. Albert Londres n’aurait sans doute pas suivi ce caillou jusqu’en Malaisie. ».
A la lecture de Minerais de sang, on comprend à quel point l’Afrique subsaharienne est définitivement impliquée dans la mondialisation, presque à son corps défendant. « Depuis le XIXe siècle, le Congo a toujours été considéré comme une terre de richesses, à piller », note-t-il encore. Un siècle plus tard, les atrocités commises dans la région des Grands Lacs ne suscitent que de faibles mouvements de protestation. Peut-être parce qu’elles n’ont pas de coupables aisément identifiables, à part un ou deux obscurs seigneurs de guerre, jugés par la Cour pénale internationale de La Haye, dans l’indifférence médiatique. A la fin de l’entretien, Christophe Boltanski parle de la « malédiction des ressources », qui frappe invariablement la population des Etats aux sous-sols trop généreusement dotés en matières premières, que ce soit du pétrole, des diamants ou des minerais rares. « On ne peut pas dire que les Africains sont responsables de la misère qui ronge leur continent. Certes, la corruption y est forte et les élites locales sont une des causes de cette situation. La responsabilité s’est mondialisée, comme le reste, mais il existe d’autres responsabilités, plus lointaines, qu’il faudrait pouvoir établir avec transparence. » Du grain à moudre pour de prochaines enquêtes ?