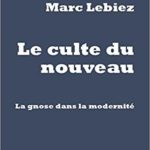Religion gnostique, le retour du refoulé
Publié le 22 février 2019 par Sylvie Taussig
L’idée : explorer les ressorts conceptuels et le long parcours sinueux de la gnose pour mieux comprendre son retour
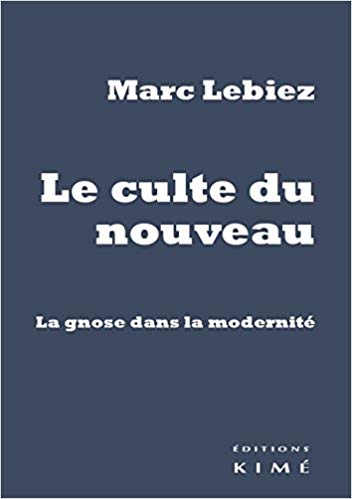
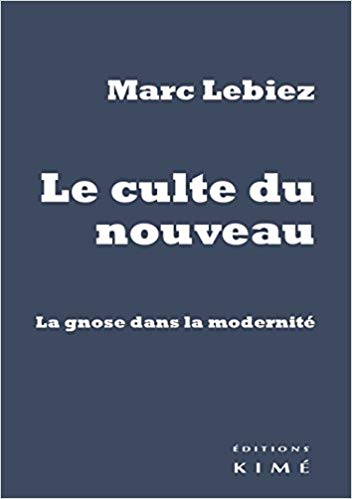
La gnose est de retour, qui structure le « désir éperdu de nouveauté »
Le travail de Voegelin et des Allemands qui n’ont pas, à la différence des Français, renoncé au pan théologique de la culture, est cependant suffisamment nourrissant pour que l’auteur examine le rapport de la gnose historique avec le Nouveau et fasse sienne l’idée que l’engouement pour le nouveau comporte une religiosité. Il décrit donc cette période complexe de la naissance du christianisme, avant que le dogme ne soit fixé par les grands conciles (Nicée et Constantinople, pour l’essentiel) et avant que les pères n’instruisent le procès des gnostiques comme hérésiarques, se retrouvant dans ce geste critique, quoique pour des raisons fondamentalement différentes, auprès de Plotin – qui par ailleurs critiquait aussi des valeurs assumées par l’Eglise. Cette période se retrouve décrite ici avec cette ironie qui permet à Marc Lebiez d’introduire des thèmes annexes, qui cassent constamment la ligne principale et la contestent de l’intérieur, pour rendre compte d’une profonde complexité historique. Il décrit le moment fondateur du christianisme tel qu’il a été immédiatement vécu et transmis comme l’irruption du nouveau, dans un univers mental qui considérait les formes éternelles comme seules dignes.
L’avènement d’un Sauveur impliquait que le présent était mauvais et que le monde devait être sauvé, parce qu’il était mauvais et, éventuellement, l’œuvre d’un dieu mauvais – pourquoi pas celui de la bible hébraïque, devenu l’ancien testament, comme Marcion le pensa, lui qui, le premier, théorisa la nouveauté (mais fut jugé hérétique). Le travail des premiers théologiens non gnostiques et des conciles fut donc la théorisation de la trinité qui mettait court, en la versant entièrement du côté de l’ésotérisme, à l’interprétation dualiste gnostique de la disjonction entre le dieu sauveur et le dieu créateur qui avait, d’emblée, des liens avec l’antisémitisme, non seulement par synecdoque du Dieu au « peuple » (le peuple était mauvais d’un dieu qui l’était), mais également parce que les juifs ne font pas partie de ceux qui ont la connaissance du salut. Cette connaissance, cette gnose, apparaît dans les textes apocryphes et dans les spéculations sur ce que Jésus aurait dit au cours des quarante jours où il revint après sa mort et résurrection : quelque chose d’essentiel doit donc être ajouté à la foi, un quelque chose qui est tu, voire caché par l’église officielle, malgré son affirmation contraire (et de fait, pendant des siècles, elle a limité l’accès aux Écritures et elle a caché aux croyants les textes apocryphes).
La gnose dessine la rupture du nouveau mais fonde sa révélation sur un savoir immémorial, transmis dans le secret
La lutte entre la gnose et les tenants de ce qui est devenu l’Église, constituant ses dogmes, a vu la victoire de cette dernière, insistant sur la nécessaire explication du Nouveau par la tradition et le magistère, se caractérisant toujours plus par le refus d’une part de toute innovation en matière doctrinale et, d’autre part, de l’ésotérisme, qui accompagne toujours la gnose, avec l’idée que seul un petit nombre d’initiés aura le salut, dès lors que c’est cette connaissance directement communiquée qui l’assure. Sans doute y a-t-il un paradoxe de voir ce bastion de la Tradition naître de l’éclosion du nouveau, ou le paradoxe que l’universalité de l’enseignement chrétien naisse de son contraire ; mais, au respect de l’exposé de Marc Lebiez, la démonstration qui s’effectue par différents ressources (déduction, induction, glissement et analogies – et argumentation antiphrastique) permet une histoire qui à la fois se place du point de vue du croyant (il ne nie pas l’authenticité et prend au sérieux l’annonce de Jésus, loin de la thèse de l’imposture, qui est balayée) sans renoncer à la distance critique : il ne nous est certes pas dit que c’est l’esprit saint qui a inspiré les textes conciliaires.
Sans doute l’Église assied-elle sa victoire contre le dualisme gnostique par une théologie solide, mais la rupture induite par le Christ demeure : elle explique, pour l’auteur, le passage de la tragédie au drame et la naissance du roman (sécularisation des récits de saint) ; mais elle persiste également au sein de l’Eglise, et ces divisions se font jour tout particulièrement au XVIIe siècle. Néanmoins, l’interprétation gnostique fut si forte qu’elle eut un effet rétrospectif sur des textes qui lui sont étrangers, et perdure jusqu’à aujourd’hui sous des modes mineurs : on glose sur les textes dits ésotériques d’Aristote (alors que le terme ésotérique a une tout autre acception chez Aristote), on valorise les mythes de Platon au détriment des textes ouverts, on insiste sur la tradition orale homérique qui dépossède Homère de sa qualité d’auteur – et la datation de Casaubon en 1614, réfutant l’ancienneté de Trismégiste, fait long feu. En fait, la gnose, un syncrétisme aux accents de pérennialisme, dessine la rupture du nouveau mais fonde sa révélation sur un savoir immémorial, transmis dans le secret, dans des lignées charnelles et par le biais de l’oralité, ce qui est à la fois signifié, par des procédés narratifs et force élaborations symboliques, dans des écrits qui ont de grandes proximités stylistiques sous les auspices d’une certaine étrangeté. La révélation toutefois s’y dérobe. L’étrangeté est un marqueur, la « coloration syncrétique » agit comme un charme. « La littérature ésotériste exhibe le fait que la vérité intéressante est dissimulée. » (p. 136) Alors que la gnose était « le souvenir de mythes religieux très anciens qui furent vivaces dans des aires culturelles vastes et variées, mis au service de l’opposition dualiste entre le Dieu de l’Ancien Testament, qui ne veut pas le bonheur des hommes, et leur Sauveur » (p. 112), une fois défaite elle se rapprocha, presque au point de se confondre avec lui, de l’ésotérisme soit « la distinction entre ceux qui peuvent accéder au savoir caché et la foule des profanes » (p. 118). Le méchant Dieu de la création ne veut pas que les hommes accèdent à la connaissance qui assure le salut.
La gnose qui est une « radicalité d’après coup » (p. 113) ne fait pas que donner son parfum à des phénomènes bien contemporains : elle les structure.
La gnose, une autre voie entre l’idéalisme platonicien et le pragmatisme aristotélicien ?
Antisémitisme, conspirationnisme, ésotérisme, règne du gourou… Tout ce qui s’oppose à la science, avance sur la base d’une méthode et implique une progression, et non une illumination. et s’enracine dans l’expérimentation et l’observation, loin de tout dualisme corps /âme. Le retour du refoulé gnostique, vaincu par les premiers conciles mais également par la civilisation issue des conflits renaissants, se lit facilement dans la philosophie de Heidegger (et jusque dans sa critique du nazisme, ici instruite à propos de la lecture des Cahiers noirs, à qui le philosophe reprochait finalement sa vulgarité, contraire au schème de l’initiation qui restreint à quelques élus l’accession à la vérité cachée à la multitude), et dans toute son ambivalence dans le cas de l’Ahnenerbe où il est bien difficile de « faire la part entre les travaux d’authentiques savants et les élucubrations de véritables imposteurs » (p. 190).
La gnose resurgit-elle à chaque moment de crise et de brassage accru des peuples, et suffit-il d’invoquer la crise (au tournant de l’ère chrétienne ou aujourd’hui) pour en rendre compte ? Pour Marc Lebiez, cette explication est un peu courte. La gnose n’est-elle plutôt la troisième voie que peut prendre la pensée, à côté de l’idéalisme platonicien et du pragmatisme aristotélicien ? Indiquer les pentes dangereuses de la gnose ne sert pas ici, à la différence de Voegelin, à parer les religions institutionnelles de toutes vertus. Au contraire, rappeler leur unique naissance, dans une expérience personnelle, incommunicable comme celle de Jésus et de Mahomet, et préciser que leur divorce, tardif, relève d’une conjonction historique, attire l’attention sur le fanatisme comme « pente » naturelle (p. 154). L’auteur saisit l’occasion de rappeler ce qu’est la science, fondée sur la raison, ne traitant « que de ce qui persiste et se répète à l’identique » (p. 157), à la différence d’une religion révélée dont le premier acte est toujours la création du monde, événement unique instaurant le nouveau et dont l’affirmation est passée par l’autodafé de beaucoup de livres.
Pour l’auteur, la Renaissance, qui revient à l’unicité du monde après le moment trinitaire né lui-même de l’opposition au dualisme, est, dans son rapport au passé en analogie avec la psychanalyse, qui refuse le produit miracle et le « sauveur », dans un « à nouveau » (p. 225) et non dans le « nouveau ». La modernité n’est donc pas condamnée au nouveau, celui-ci est même plutôt sa perte, car il y a un « lien systémique entre dénonciation d’un monde qui serait fondamentalement mauvais, attente d’un Sauveur, dualisme, attirance pour les savoirs cachés et antisémitisme ».