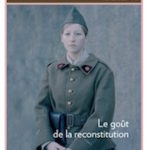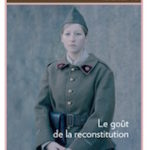Philippe Artières : scènes de reconstitution
Publié le 29 mai 2019 par Les Influences
L’idée : l’historien a dirigé le thème de la revue Sociétés & Représentations ( Éd. de la Sorbonne) consacré au « goût de la reconstitution ». De l’étude des ruines antiques à la BD et aux Playmodélistes, les pratiques sont elles aussi à envisager comme des objets d’histoire.


La reconstitution acceptée en tant qu’outils de recherche par les préhistoriens et médiévistes, est discréditée par les historiens des périodes modernes
Le chercheur, et par ailleurs grand ordonnateur de scénographies historiques (Alcatraz, Mai 68) sait stimuler les interrogations. Des « frottements » dit-il, qui mettent le feu à la réflexion. En bon foucaldien et auteur lui-même d’un fait-divers familial reconstitué, il note dans son introduction, que la reconstitution provient de la criminologie.« La reconstitution apparaît alors comme un élément institutionnalisé participant du deuil ».
L’exploration est passionnante. La technique est bien connue des préhistoriens, de spécialistes de l’Antiquité et de médiévistes et depuis, ces usages ont largement débordé le cadre de la recherche. Mais elle demeure toujours extrêmement critiquée, si ce n’est discréditée par les historiens des périodes modernes et contemporaines qui n’en voient que stephaneberneries ou lorandeutscheries, ou qu’un domaine ludique dévolu aux artistes et autres producteurs d’artifice. 
La Therapeia ou la Vetustas
L’archéologue Alain Schnapp ouvre le bal du concept, avec une réflexion sur l’usage des ruines à l’Antiquité elle-même. Comment ces sociétés et leur pouvoir concevaient-t-elles cette mémoire des lieux et des pierres ? La Therapeia contre la Vetustas, cette force du temps qui passe et qui dégrade tout. Le chercheur fait ressortir l’étonnant vocabulaire inflationniste, et même une « amphigourie », si ce n’est un « délire verbal » concernant les termes de la protection des monuments en Grèce et à Rome. Sous ces ruines, on trouve le pouvoir. Vis-à-vis des monuments, les empereurs et les tyrans bâtisseurs opèrent un « va-et-vient continuel » entre le passé et l’actualité du présent.
« Néron incarne une dimension paroxystique de l’exaltation du présent, relève Alain Schnapp. Comme Shi Huang, le premier empereur de Chine, il entend se débarrasser du passé; la vieillesse des temps passés (tempora priora) est une menace. Il faut partout du neuf, même s’il tient son élégance de formes et de traditions plus anciennes ». Les monuments doivent être « les traces intelligibles de ce qui est advenu », car maîtriser le passé revient à maintenir le présent. Cicéron : « Ignorer ce qui est advenu avant d’être né, c’est rester toujours un enfant. »
L’ours chamanique de Prats-Mollo et les « playmodélistes »
La revue n’en parle pas, temps d’élaboration oblige, mais dans cette période de Gilets jaunes qui mimaient sur les Champs Élysées, des répliques révolutionnaires et de combats urbains, s’assimilant volontiers aux sans-culottes, la Révolution française et ses références ne cessent d’être l’enjeu de mémoires diverses. La Vendée de Philippe de Villiers en a fait une extraordinaire cash-money, le Puy du fou et ses grands spectacles de reconstitution historique talonnant en chiffre d’affaires, Eurodisney. Pour l’historien Guillaume Mazeau, les reconstitutions pourraient participer à une déprise des chercheurs de cette période, toujours particulièrement tribalisés ( les Robespierristes, les libéraux, les royalistes et quelques républicains radicaux), à une érosion de leurs liens de fidélité, véritables laisses idéologiques, et à faire bouger leurs a-priorismes. On peut toujours rêver. Tout n’est pas reconstituable, comme le montre l’historien du patrimoine, Dominique Poulot, avec l’exemple du musée excentrique du catharisme imaginé par Déodat Roché, « un personnage exceptionnel mais peu lisible ».
La fête de L’Ours de Prats-Mollo qui, durant des siècles, hantait les villages, s’est considérablement modifiée au fil de ces dernières années. La reconstitution concerne La manifestation païenne et paillarde s’est « métamorphousé » comme l’écrit l’anthropologue Claudie Voisenat, « En dépit de leur ancienneté, ou mieux, en raison de cette ancienneté, les fêtes de l’Ours relèvent bien d’une reconstitution, non pas celle, matérielle, d’un passé mis en scène avec ses costumes, ses gestes, ses décors, mais celle du sens, perpétuellement ravaudé, restauré, à mesure que le temps et les transformations sociales le délient, le dénouent », analyse t-elle.
Ainsi, l’Ours, avec l’influence du tourisme mystique, a sensiblement changé de statut depuis les années 2000 : sa carcasse inquiétante au sexe impressionnant, grand amateur de chairs fraîches, se profile désormais en chaman pelucheux.


On notera dans la même revue, le grand entretien de l’actrice Dominique Blanc qui raconte à Myriam Tsikounas, comment elle a interprété Madame de Maintenon dans L’Allée du roi.