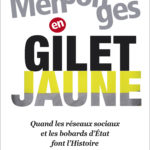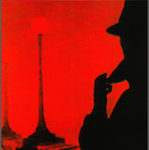Sylvain Boulouque : Les Gilets jaunes, entre la manif 2.0 et un néo mouvement poujadiste paysan
Publié le 19 novembre 2019 par Les Influences
L’idée : Le spécialiste des radicalités et auteur de Mensonges en gilet jaune (Serge Safran éditeur) analyse une année de colère fluo dans la perspective historique des colères françaises.
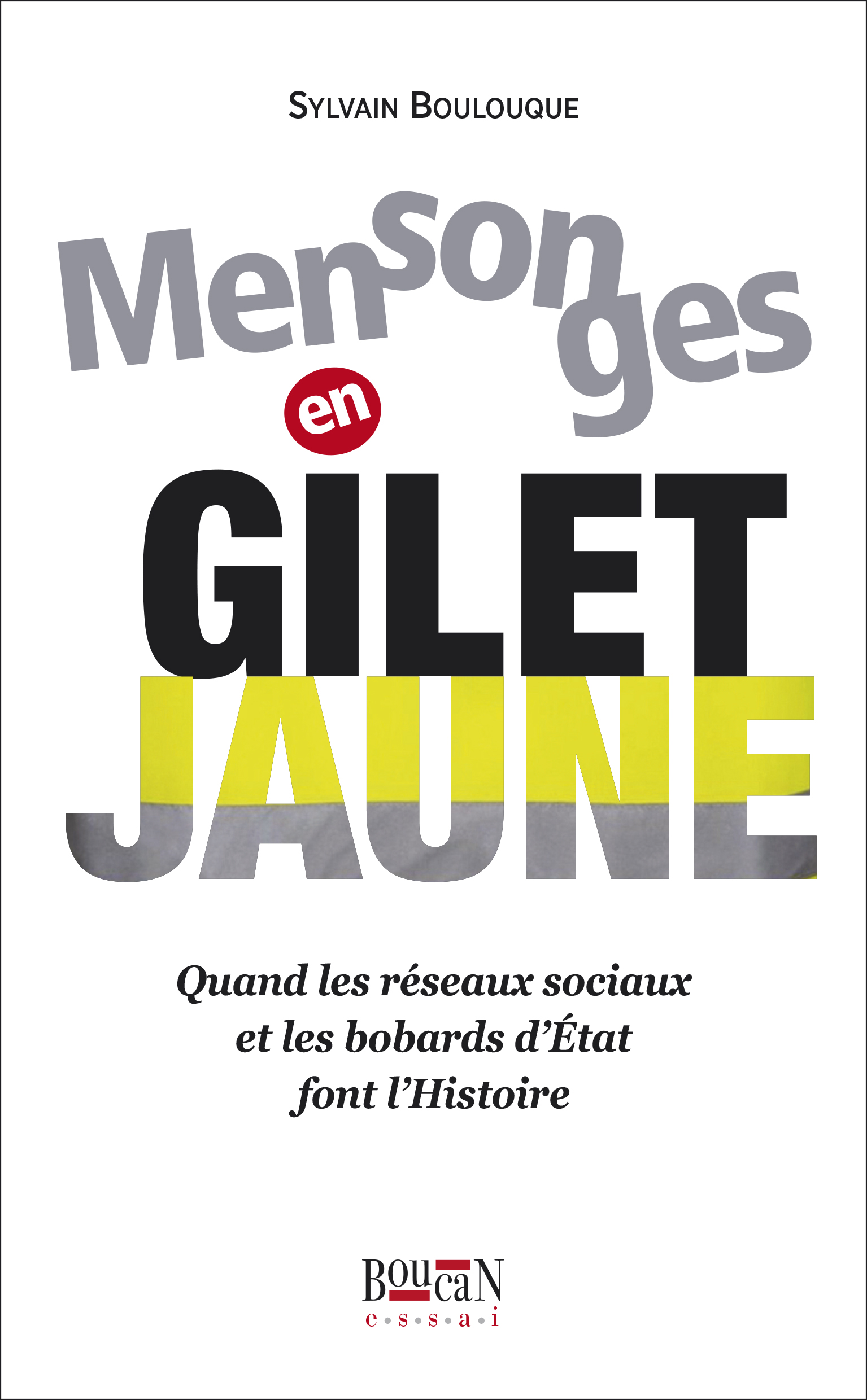
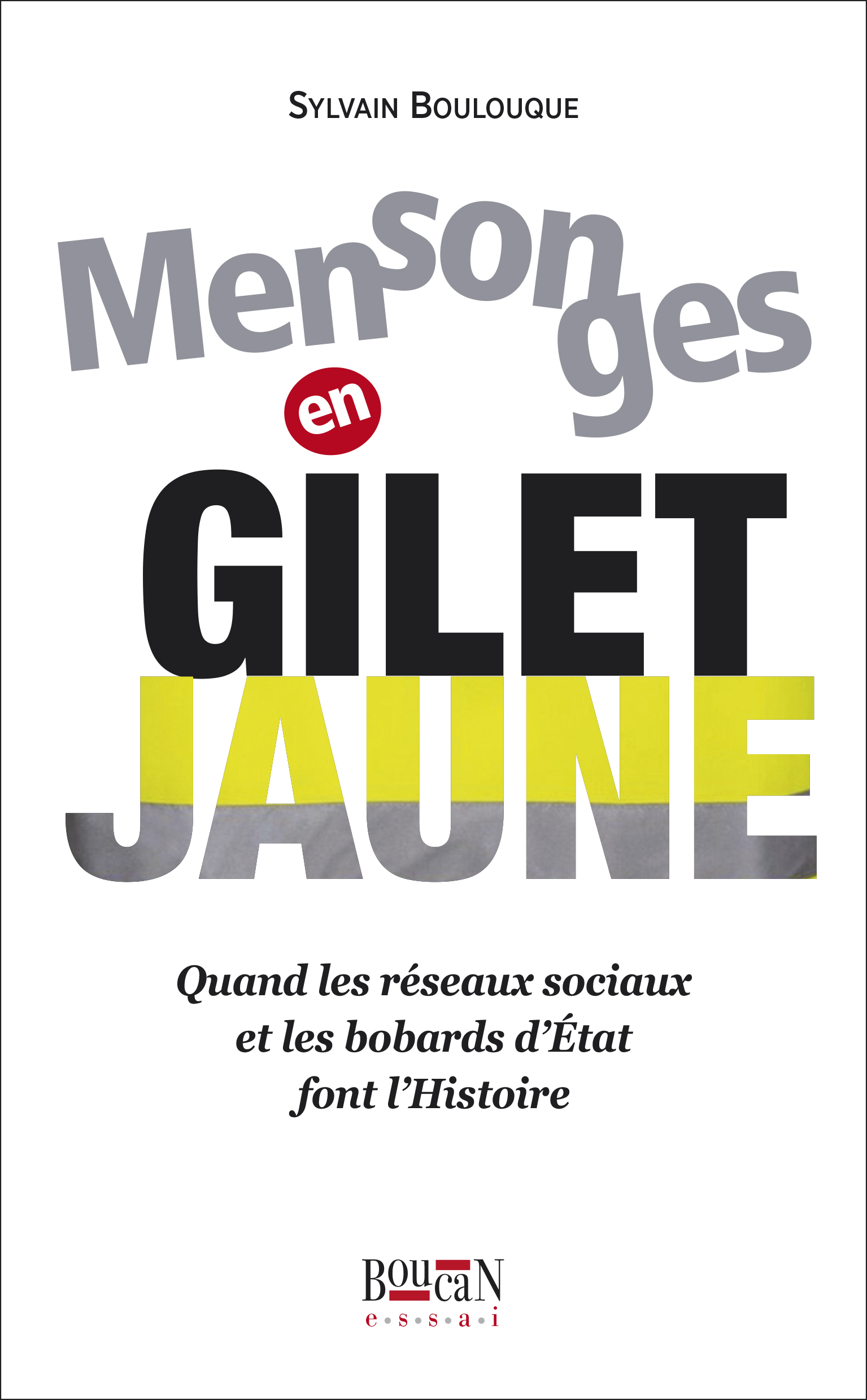
![]() SOCIÉTÉ Un an après et comme on peut le constater depuis le samedi 16 novembre, qu’est ce qui a changé dans la nature du mouvement des Gilets jaunes ?
SOCIÉTÉ Un an après et comme on peut le constater depuis le samedi 16 novembre, qu’est ce qui a changé dans la nature du mouvement des Gilets jaunes ?
Plusieurs choses. Le nombre d’abord n’est plus le même. Ce qui s’explique par la peur des violences qu’elles soient policières ou militantes. Il s’explique aussi par le fait qu’une partie des Gilets jaunes a obtenu satisfaction sur des points comme le 80 km/h ou la taxe carbone. Donc ces Gilets jaunes ont fait leur la phrase de Thorez, à la sauce fluo : « il faut savoir arrêter un rond-point quand on a obtenu satisfaction ». Ensuite la nature des revendications n’est plus la même. Elle est passée de « À bas les taxes et les impôts » à « On veut des services public et rendre service au public ». Le mouvement est toujours aussi protéiforme, même si l’extrême droite a déserté et si le gros des bataillons semble plutôt attiré par la droite, alors que les revendications ont une tonalité de gauche.
Votre essai est aussi une réflexion sur les effets des rumeurs et des propagandes, des réseaux sociaux comme de l’État. Pourquoi l’abondance de matériau vidéo et informationnel ne permet-elle pas au chercheur, une appréhension plus fine et plus complexe d’un tel mouvement ?
Il faudra voir sur le long terme pour une réponse complète. Les chercheurs commencent tout juste à travailler sur le sujet. Il risque d’y avoir deux écueils principaux. D’abord une partie d’entre eux est partie tête baissée et creuse selon les mots d’ordre du moment et risquent fort d’avoir un regard décalé, si ce n’est stéréotypé, sur ce mouvement. Ensuite une partie des Gilets jaunes, notamment ceux des premières semaines, ne parleront pas, les uns pour des raisons politiques et d’autres pour des raisons sociales (défiance, refus des enquêtes, etc.). Cependant, les matériaux déjà existants permettent d’abord une première approche… à la condition de penser contre soi et de se rappeler que l’au-delà du discours existe pour toutes les pensées politiques.
Les femmes participant au mouvement ont été ensevelies sous les bruits des autres.
L’État répond-il façon adéquate à ce genre de mouvement ?
Difficile de répondre à cette question compte tenu de la nature même de ce mouvement. Tout dépend du rôle que chacun veut donner à l’État et du type de revendication examinée.
Vous remarquez que les Gilets jaunes ont raté l’occasion d’être un mouvement féministe historique. Comment expliquez-vous ce décrochage avec une population précaire et fragile que sont les mères célibataires ?
Les femmes participant au mouvement ont été ensevelies sous les bruits des autres. D’abord pour des raisons familiales, il est difficile d’aller tout le temps dans ces manifs quand vous avez des enfants que vous élevez seules. Ensuite, ces manifs pouvaient s’avérer dangereuses en raison des violences policières comme manifestantes, donc pour la même raison, la protection des enfants, vous hésitez à y participer. La protestation a été enfouie sous le brouhaha des médias, alors que leurs revendications antifiscales sous-entendaient une redistribution différentes des richesses. Enfin, il suffit de regarder la société pour voir que la vie des femmes continue d’être réduite au silence et considérée avec mépris et dédain.
Les revendications sont passées de « À bas les taxes et les impôts » à « On veut des services public et rendre service au public »

Le nouveau, c’est sa forme 2.0 et ses nouvelles méthodes de mobilisations via les réseaux sociaux déstructurant les formes traditionnelles d’organisation, qui par ailleurs sont mal en point. Le rôle des mères célibataires, on en a parlé, est un ingrédient intéressant. Ensuite, ce mouvement au moins dans sa forme initiale ne s’inscrit pas dans une lutte sociale. Il est d’abord à l’intersection de plusieurs mouvements poujadistes, singeant parfois les révoltes (et la violence) paysannes des années 1960. Depuis le mois de décembre/ janvier il a repris des formes plus classiques de militantisme à gauche, beaucoup émeutière et parfois réformiste.

QUE LISEZ-VOUS ?
SANS PATRIE NI FRONTIÈRES DE JAN VALTIN ET DES BD LIBERTAIRES
J’ai participé à un colloque vendredi 15 novembre à Poitiers sur Jan Valtin et j’ai relu pour la xième fois son Out of the night (Sans patrie ni frontières, Actes sud) récit contenant quelques erreurs marginales mais qui, à chaque fois que j’ai pu le confronter aux archives à été d’une extraordinaire vérité. 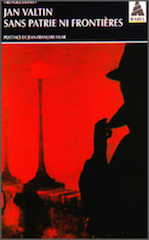 C’est réellement un témoignage remarquable sur le plan littéraire et avec un souffle de récit.
C’est réellement un témoignage remarquable sur le plan littéraire et avec un souffle de récit.
Pour ma rubrique BD dans la revue L’Ours, je viens de lire deux bandes dessinées qui évoquent l’une Makhno et l’Ukraine insurgée, Le vent des libertaires (Les Humanoïdes associés) de Philippe Thiérault et Robertho Zaghi et l’autre, le dernier volume de Mattéo de Gibrat (Futuropolis) qui se bat en Espagne dans une colonne libertaire.
L’embouteillage lié au travail est tellement important que ces derniers mois, je n’ai pas eu le temps de lire ou relire pour moi un roman, avec une préférence pour les grandes épopées russes comme celles de Vassili Grossman…