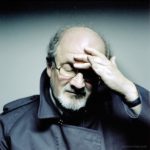L’Inde invitée : Ce que l’on ne verra pas au Salon du Livre de Paris
Publié le 18 février 2020 par Les Influences
ASPHYXIES INDIENNES (3/4). Bernard Turle est l’un des meilleurs traducteurs français de littérature indienne. Mais entre pollution climatique hallucinante et pollution politique autoritaire, il ne se reconnaît plus dans l’Inde de Modi.
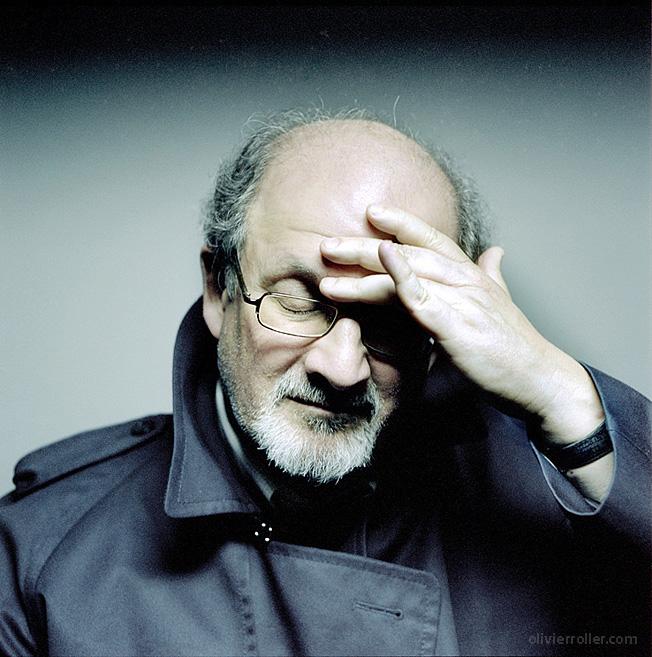
![]() RÉCIT Il sera intéressant de voir ce qui se passera au prochain Salon du Livre de Paris (20-23 mars 2020), dont le pays invité d’honneur est l’Inde. Les éditeurs français attendent à ce jour du gouvernement de Delhi la publication de la liste des auteurs autorisés à participer, une pratique habituelle mais dont la teneur, dans le cas présent, pourrait donner des indications sur la relation pouvoir/censure dans le cadre du second mandat de M. Modi.
RÉCIT Il sera intéressant de voir ce qui se passera au prochain Salon du Livre de Paris (20-23 mars 2020), dont le pays invité d’honneur est l’Inde. Les éditeurs français attendent à ce jour du gouvernement de Delhi la publication de la liste des auteurs autorisés à participer, une pratique habituelle mais dont la teneur, dans le cas présent, pourrait donner des indications sur la relation pouvoir/censure dans le cadre du second mandat de M. Modi.
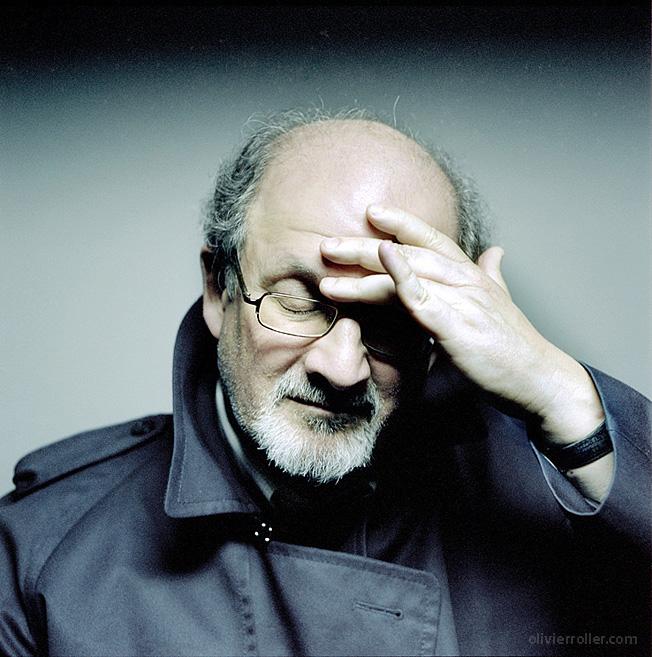
Certains ouvrages présentés au Salon traitent de l’implication directe du PM indien mais on peut imaginer qu’ils se fondront dans la masse des salamalecs dont les cercles culturels indiens raffolent et auxquels se soumettront les cercles politiques et culturels de l’Hexagone, soucieux de continuer à vendre à la République indienne les miroirs aux alouettes que sont les Mirages et autres Rafales.
La « crême de la crême de la littérature indienne » a menacé de ne plus écrire sous ce régime : 3% seulement de la population parle l’anglais
Réagissant aux massacres, à l’intolérance et aux « violentes attaques » du parti de M. Modi, le BJP, « contre la diversité culturelle », « la crème de la crème de la littérature indienne » s’était donc insurgée, allant jusqu’à promettre de ne plus écrire. Dans un pays où 3 ou 4%, au plus, de la population parle anglais, la langue d’élection de cette crème de la crème, on imagine aisément l’impact d’une telle menace. Salman Rushdie avait apporté un retentissement international à l’affaire mais, dans un monde soumis au joug des boutiquiers milliardaires, les propos d’un écrivain n’ont aucun poids, et la crainte que les violences, comme la recrudescence des viols, rebutent les investisseurs s’est révélée infondée, puisque, hormis le fait que l’argent est la valeur suprême du système dominant, le racisme et la misogynie ne sont plus des obstacles, au contraire, ils sont la norme autorisée par toute une série de despotes. Le ministre de la culture d’alors, Mahesh Sharma, eut beau jeu de déclarer : « S’ils se disent incapables d’écrire, qu’ils cessent d’écrire ». Les intellectuels indiens n’avaient pas l’habitude d’être ainsi réduits à néant mais ils s’y sont habitués, la réélection triomphale de M. Modi cette année a donné un blanc-seing à son gouvernement et à ses soutiens les plus agressifs. Elle a parallèlement fait taire les quelques voix dissidentes : écrivains, poètes ou essayistes semblent désormais faire profil bas, ce qu’on fait généralement, question de survie, dans un État totalitaire et religieux. Car cet État repose entre autres sur la menace, bien réelle, celle-là, que fait peser sur les récalcitrants la force musculaire des sbires anonymes à sa solde, à travers tout un réseau de relais plus ou moins opaque qui garantit au patron une immunité au-dessus de tout soupçon.
À SUIVRE
Les fumées noires de Mister Modi (1/4); Brexit : pourquoi Boris Johnson se rapproche de l’Inde (2/4); Goa, des hippies aux paramilitaires hindous (4/4).