En direct du Cap et de la Coupe du Monde
Publié le 13 juin 2010 par Les Influences
Où la vuvuzela et la rumeur dans un stade du Cap pendant France-Uruguay nous font penser à l’acousmatique.

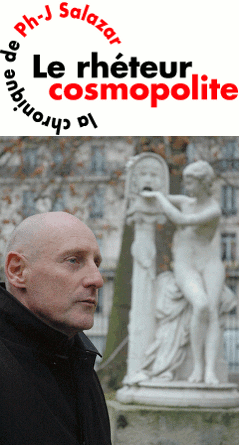
Embéquant ma vuvuzela, jaune et vert, et coiffé d’un casque de centurion aux couleurs de l’Afrique du Sud, « le géant qui s’éveille » (d’après The Economist) je me pris à songer, dans le bourdonnement hénaurme des trompettes zouloues soufflées sans unisson mais à la force des poumons, je me pris à songer à un mot – « rumeur ».
Dire ce que l’on a entendu dire
« Rumor », en latin, c’est le bruit qui monte des champs de bataille, le bruit que fomente la mêlée des hommes et des armes, des sabots et des roues, des cris de joie et des halètements de mort, le bruit des hommes qu’entendent les dieux. La « rumeur » c’est ce à quoi, de loin, d’ailleurs, d’autrement, nous ressemblons. Du stade du Cap, magnifique chapeau xhosa posé entre trois océans, là où le géant Adamastor de la Louisade imaginé par Camoens et chanté dans L’Africaine de Meyerbeer, relevait sa tête et ouvrait la gorge, montait une « rumeur ». Et puis, cet unisson, ce bruit d’essaim d’abeilles produit par des coups de gosier désaccordés, n’était-ce pas, presque, un commentaire sur un passage d’Aristote, où (rappelle Barbara Cassin), la démocratie est un pique-nique : chacun y apporte son bout de lard et, de ce manque d’unisson gastronomique, on fait un banquet. De coups de vuvuzelas à tire larigot, un concert humain.
Où en viens-je avec ma vuvuzela, la rumeur, le pique-nique, et Aristote ? A un commentaire sur, je suis en mal de mots rares, « l’acousmatique » et l’état rhétorique de la République.
Définition de l’acousmatique : l’acousmatique caractérise cet art très humain, et très politique, de « dire ce qu’on a entendu dire », littéralement c’est la connaissance par le ouï-dire redit. Bref, c’est l’art de répéter des opinions entendues, comme si avoir entendu suffit à valider leur vérité. La véridicité (le dire vrai : je dis ce que j’ai vraiment entendu, par exemple : le président a pour maîtresse Lady Gaga, et tel sous-ministre, beau gosse, n’est pas « a gay », comme dit la fameuse comédienne Catherine Tate) floue la véracité (dire le vrai).
Je laisse de côté la véracité, c’est une affaire qui ne devrait concerner personne en politique, car elle demande du temps, des efforts, et certainement pas l’élévation germanique du « sport tous les après-midis » au rang d’instruction des « vraies valeurs » (dixit un sous-ministre) aux dépends des disciplines qui forment donc, elles, aux fausses valeurs de la véracité, comme la philo, le français (voyez les courges qui attaquent l’analyse littéraire ou M. Pujadas qui se moque, en conclusion de son journal téléguidé, de l’ « hémistiche »), comme les maths (Descartes, RIP †), et, certes, sans jamais envisager à renforcer l’éducation musicale et l’éducation artistique (Platon, Augustin, Valéry, nous en sommes désolés, mais si on peut demander à un prof de français d’aller taper dans un ballon, lui demander de jouer du violon c’est une autre affaire).
L’oreille amie
 Le dire vrai, la véridicité, est une simple machine : machin m’a dit que, et si machin offre une ou deux preuves de son dire (trois, c’est mieux, lisez plus bas), c’est que c’est vrai. Voici une recette de communiquant, et qui marche à tous les coups y compris les coups bas, comme disait le colonel Cambe, de la Légion, et mon prof de philo au lycée de Tarbes, Hautes-Pyrénées : vous inventez une histoire vraisemblable, vous usez de trois preuves ; une preuve logique (« Je te dis cela sous le sceau du secret, et à preuve, quand X avait parlé de l’affaire x à Y, c’était vrai, tu t’en souviens, mais on l’a ébruité, parce que, bon, c’était vrai ») ; une preuve éthique : « Tu sais très bien qui je suis, et je peux y laisser des plumes, mais cette affaire est trop importante, elle me dépasse, donc.. ») ; une preuve pathétique (« J’en peux plus de garder ça pour moi, ça me ronge, on prend un café ? » je dois « unloader » – (=« se décharger émotionnellement ») ». Cela c’est la machine rhétorique, tout prête, mais n’actionnant rien.
Le dire vrai, la véridicité, est une simple machine : machin m’a dit que, et si machin offre une ou deux preuves de son dire (trois, c’est mieux, lisez plus bas), c’est que c’est vrai. Voici une recette de communiquant, et qui marche à tous les coups y compris les coups bas, comme disait le colonel Cambe, de la Légion, et mon prof de philo au lycée de Tarbes, Hautes-Pyrénées : vous inventez une histoire vraisemblable, vous usez de trois preuves ; une preuve logique (« Je te dis cela sous le sceau du secret, et à preuve, quand X avait parlé de l’affaire x à Y, c’était vrai, tu t’en souviens, mais on l’a ébruité, parce que, bon, c’était vrai ») ; une preuve éthique : « Tu sais très bien qui je suis, et je peux y laisser des plumes, mais cette affaire est trop importante, elle me dépasse, donc.. ») ; une preuve pathétique (« J’en peux plus de garder ça pour moi, ça me ronge, on prend un café ? » je dois « unloader » – (=« se décharger émotionnellement ») ». Cela c’est la machine rhétorique, tout prête, mais n’actionnant rien.
Dès que « moi, l’oreille amie », je colporte l’affaire, la machine de véridicité se met à fonctionner, et le dire vrai embraye à plein régime. Les vuvuzelas sonnent alors non pas à l’unisson, car chacun y va de sa version et y apporte son intonation ou module son volume et son timbre, mais, cornettant ensemble, elles donnent l’impression non pas d’une unanimité de vues mais l’impression, acousmatique donc, que « c’est vrai » et que, vu de loin, le « rumor » produit de l’assentiment.
Plus on va dans la déchéance de la République, et moins le citoyen moyen possèdera les moyens de comprendre comment marche le « dire vrai » politique, et il les aura de moins en moins avec les réformes évoquées où le sport va déporter (même mot, d’ailleurs : « sport » et le vieux « desport ») la citoyenneté vers la pratique de la vuvuzela.
L’excitation émotionnelle ou les trompettes de Jéricho
Bientôt, nous vivrons dans une république de vuvuzelas où dans le bruit commun, l’excitation émotionnelle et la chaleur humaine achetés aux mafias sportives, et sans oser une seule huée qui puisse gâcher le pique-nique, interrompre la rumeur et affirmer que nous ne sommes que des abeilles dans une ruche à produire du miel pour nos reines et rois, nous serons là, à chérir, à acclamer, à montrer en exemple des tricheurs, des violeurs et des échappés fiscaux se drapant dans les couleurs de Valmy, des Trois Glorieuses et de l’Appel du 18 juin.
Mais l’autre modèle des vuvuzelas ce sont les trompettes de Jéricho… You have been warned.


