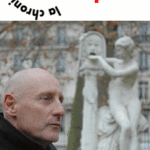Du Caire, rhétorique d’une révolution sur Al Jazeera
Publié le 29 janvier 2011 par Les Influences

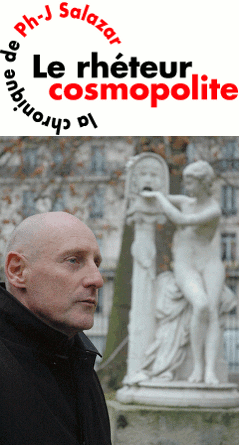
Qu’est-ce, rhétoriquement, le direct en continu ?
Durant sept heures le vendredi et une partie de la nuit qui suivit, Al Jazeera ne savait pas nommer directement ce qui se passait mais seulement montrer en direct ce qui se passait : des images, mais pas de mot pour les nommer, dans une étrange coupure entre l’effet brutal de réel procuré par le direct (« regardez et jugez ») et le manque d’effet de sens du fait de l’absence de mots stables pour nommer ce que les images montraient. Je précise : qu’on ne me dise pas que parce que l’événement se déroulait il était difficile de le nommer afin de ne pas en travestir la vérité car, dans ce cas, pourquoi prétendre que les images transmises en continu, avec seulement deux angles de prise et quelques cadrages, avaient, elles, une valeur de vérité se passant de commentaires ? On touche là à une question radicale, sur le degré d’évidence que les mots ont, ou n’ont pas, par rapport aux images.
Cette question est rhétorique puisqu’il y va du pouvoir effectif de persuasion que les images ont, plus ou moins que les mots. Le fait est que « la vue est le sens par excellence » (Aristote)[[Aristote, De anima, III, 3, 429a 2-4.]], c’est à dire qu’elle est le protocole d’évidence par rapport auquel nous mesurons la vérité des autres sens : un mot fait vrai si on peut lui donner le même degré d’immédiateté qu’une photo (d’où, en mauvaise psychothérapie, le baratin qui vous fait soudain « voir » un trauma induit par des mots, une « scène originelle ») ; très longtemps on a cru que la musique était comme une « illustration », faisait tableau (pensez aux explications désuètes sur telle tempête sur la campagne allemande dans telle symphonie ultra-rhénane). Aristote ajoute : « Jamais l’âme ne pense sans fantasme »[[Aristote, De anima, III, 7, 431a 16-17.]]. Il veut dire par là que penser implique l’apparition (« phantasia », fantasme) des objets sur quoi la pensée se porte quand ils apparaissent, soit matériellement en face de nous (par la sensation) ou matériellement dans notre pensée, soumis dans les deux cas à un processus d’assimilation – le jugement. De fait, ce n’est pas parce que, depuis ma navette spatiale, la Terre m’apparaît plus petite que le hublot par lequel je la regarde, que je vais juger que c’est sa taille réelle[[J’ai modernisé son exemple, du soleil (De Anima, III, 3, 428a 24b 10).]]. Et pourtant, quand on passe à l’exercice de la raison pratique, bref la vie avec les jugements que nous portons à longueur de journée sur « bus ou métro ? », « on prend un café maintenant, ou plus tard ? », « la Tunisie, à votre avis, c’est une situation sécuritaire, je vais dire quoi ? », et mieux encore à l’exercice de la raison publique portant sur des « fantasmes » politiques (c’est à dire des choses qui apparaissent, sous nos yeux ou dans notre esprit, qui ont une valeur politique), nous devenons soudain et souvent naïfs. Nous croyons que la Terre est plus petite que le hublot. Nous laissons la fantaisie piéger le jugement, et le visuel, critère par excellence du réel-vrai, piéger la pensée.
C’est là tout le problème de la retransmission en direct d’un événement alors que l’événement apparaît : alors que sa phantasia se déroule, le jugement est soumis à la succession des images et, au bout d’un moment, le jugement, endolori par les images, anesthésié par les fantasmes, se coule dans le rythme de l’apparition qui, comme apparition, n’a pas d’autre réalité que la succession des actes : si l’événement apparaissant était un script, un scénario, on pourrait savoir, ou on saurait, à l’avance comment ça finira, et le jugement porterait alors sur le montage de l’intrigue, bref on porterait un jugement en comparant moyens mis en œuvre et effets obtenus, par exemple un suspense formidable par quoi l’astronaute, saisi de folie, croit vraiment que la Terre est plus petite que le hublot. En politique-et-en direct il n’existe pas de scénario, seulement l’événement apparaissant qui donne lieu soit, justement et au sens banal du mot, à des fantasmes interprétatifs (les commentateurs experts, les politiciens, les autres journalistes, les « témoins »), soit à l’utilisation du direct pour nourrir l’événement lui-même, en feed back (la chaîne, étrangement, continuait d’émettre librement tandis que le gouvernement avait quasiment bloqué les réseaux électroniques, et donc les protestataires et leurs supporteurs pouvaient visionner leur événement).
Ce qui se passe est donc ceci : sans scénario le jugement saute d’acte en acte et s’en remet à l’effet de réel des images au point que, clairement, les différentes personnalités qui surgissent sur l’écran pour donner leur avis sont là comme un supporting cast, des comparses, des extras. Leurs mots émaillent les images et paraissent étrangement désincarnés, spectraux, fantastiques, une sorte de doublage qu’on accepte puisque la télé c’est mot+image, mais qui nous paraît comme moins que les images, leur pâle doublure. Le sommet du fantastique aura été l’apparition du patron de la com’ de la Maison blanche, cherchant ses mots, répétant des banalités, incapable de rivaliser avec l’effet de réel produit par la phantasia des images défilant sur Al Jazeera.
A quoi tend en fait le direct ? Au scénario : à un certain moment la chaîne décide de commencer le direct (après la prière du vendredi et les premiers accrochages) (début du script), dans l’espoir que de la suite en direct d’actes imprévisibles, simplement apparaissant, (épisodes du storyboard) surgiront une révolution et la chute, en direct, du régime (conclusion). Le paradoxe est donc que la chaîne pré-juge en se confiant, aveuglément, aux images « sans quoi on ne pense pas ». Bref : en décidant d’arrêter le débit de l’information générale, de faire du breaking news ce qui véritablement « casse » celle-ci et d’introduire soudain un événement apparaissant, durant des heures et en ignorant le reste des nouvelles mondiales, Al Jazeera ne pré-juge non pas du résultat du scénario mais que l’enchaînement aléatoire des actes apparaissant et le hasard fantastique d’une caméra sur un balcon suffisent à fabriquer un effet d’évidence, un protocole de vérité, et un acte de jugement. Pure rhétorique.
Je rêve d’une révolution télévisuellement apparue où nous n’aurions que des analyses, et dont où on nous montrerait, après coup, les images.