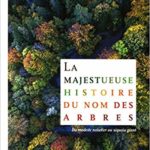Penser les arbres avec Henriette Walter
Publié le 3 août 2018 par Les Influences
Rencontre savante sous des arbres d’ici et d’ailleurs avec la linguiste Henriette Walter et Pierre Avenas, ingénieur des Mines, auteurs de « La majestueuse histoire du nom des arbres » . Idée passionnante : croiser l’étymologie et les sciences naturelles.
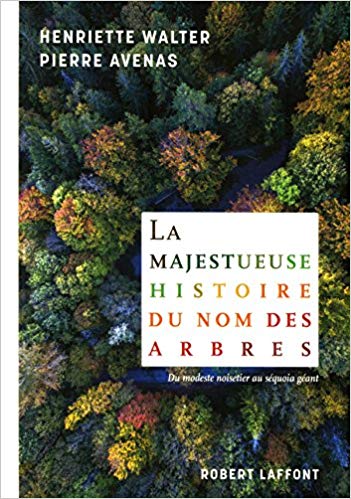
Henriette Walter et Pierre Avenas, La majestueuse histoire des arbres, Robert Laffont, 576 p., 24 €. Publication : novembre 2017.
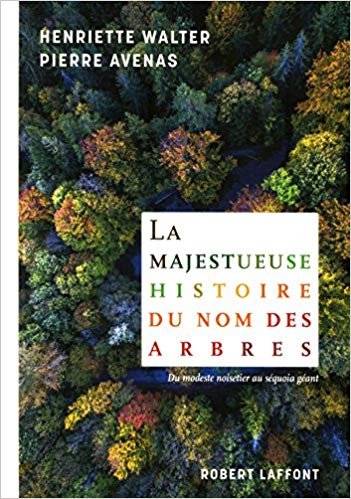 Savoirs. Le jour de notre rencontre, en cette chaude journée d’été à Paris, Henriette Walter, professeur émérite de linguistique à l’université Rennes-II, présidente de la Société internationale de linguistique fonctionnelle, et Pierre Avenas, ingénieur des Mines, viennent tout juste d’apprendre qu’ils recevront début septembre le 1er Prix Emile Gallé 2018, remis par la Société centrale d’horticulture de Nancy pour leur ouvrage La majestueuse histoire du nom des arbres . Pierre Avenas note avec malice qu’ils pourront se promener Parc de la Pépinière… pour voir les arbres ! Henriette Walter se tourne vers moi : « Les arbres sont nombreux dans nos villes mais la plupart du temps on n’y prête pas attention. Regardez Paris, c’est un véritable arboretum avec 100 000 arbres plantés le long des rues et des places ». Les platanes, les marronniers, les tilleuls et les sophoras sont les arbres d’alignement les plus nombreux dans la capitale. « La période haussmannienne a été très favorable aux plantations, observe Pierre Avenas, beaucoup d’ormes ont été plantés ». Au 19e siècle, il existait 30 000 ormes à Paris, il n’en reste plus que 10 000. Victimes d’un champignon tueur, ils disparaissent inexorablement. Dans leur livre Pierre Avenas et Henriette Walter évoquent le grand résistant de cette essence : il se trouve au pied de l’église Saint-Gervais-Saint-Protais, dans le 4e arrondissement, descendant d’une lignée d’ormes qui se succèdent ici depuis le Moyen Âge.
Savoirs. Le jour de notre rencontre, en cette chaude journée d’été à Paris, Henriette Walter, professeur émérite de linguistique à l’université Rennes-II, présidente de la Société internationale de linguistique fonctionnelle, et Pierre Avenas, ingénieur des Mines, viennent tout juste d’apprendre qu’ils recevront début septembre le 1er Prix Emile Gallé 2018, remis par la Société centrale d’horticulture de Nancy pour leur ouvrage La majestueuse histoire du nom des arbres . Pierre Avenas note avec malice qu’ils pourront se promener Parc de la Pépinière… pour voir les arbres ! Henriette Walter se tourne vers moi : « Les arbres sont nombreux dans nos villes mais la plupart du temps on n’y prête pas attention. Regardez Paris, c’est un véritable arboretum avec 100 000 arbres plantés le long des rues et des places ». Les platanes, les marronniers, les tilleuls et les sophoras sont les arbres d’alignement les plus nombreux dans la capitale. « La période haussmannienne a été très favorable aux plantations, observe Pierre Avenas, beaucoup d’ormes ont été plantés ». Au 19e siècle, il existait 30 000 ormes à Paris, il n’en reste plus que 10 000. Victimes d’un champignon tueur, ils disparaissent inexorablement. Dans leur livre Pierre Avenas et Henriette Walter évoquent le grand résistant de cette essence : il se trouve au pied de l’église Saint-Gervais-Saint-Protais, dans le 4e arrondissement, descendant d’une lignée d’ormes qui se succèdent ici depuis le Moyen Âge.
Comment choisir parmi les 70 000 espèces d’arbres et arbustes recensées par les botanistes ?
L’ouvrage sur les arbres est le quatrième opus d’une saga étymologique et naturaliste commencée il y a vingt ans. « L’idée initiale de croiser l’étymologie et les sciences naturelles vient de Pierre » précise Henriette Walter. Il raconte : « Je suis venu la voir avec un projet de 200 pages sur les mammifères après lui avoir écrit une lettre comme un étudiant cherchant son futur directeur de thèse. » Le verdict de l’illustre linguiste tombe dès le premier dîner : l’idée est invendable mais passionnante. L’alliance fera merveille et donnera tort à Henriette Walter sur le premier point. Avec ces drôles de dictionnaires sur les noms des mammifères, des oiseaux puis des poissons et aujourd’hui des arbres, les deux auteurs ont réussi leur pari, « amuser, instruire, distraire ».
Comment choisir parmi les 70 000 espèces d’arbres et arbustes recensées par les botanistes ? Leur critère est simple : ne retenir que les noms d’arbres figurant dans les trois dictionnaires usuels du français (Petit Larousse, Petit Robert, Dictionnaire Hachette). Au final, deux cents élus entremêlent faits botaniques, histoires mythologiques, lieux géographiques, digressions littéraires… « Pierre réunit les connaissances scientifiques, moi je me penche sur les mots, d’abord j’approfondis les questions de phonétique, ensuite j’aborde le lexique. Nous travaillons ensemble sur l’étymologie » explique Henriette Walter. Restent les exceptions à la règle. Le pernambouc, par exemple, a eu droit de cité. Des amis musiciens de Pierre Avenas savent que l’archet fait de ce bois précieux est inégalable pour les violonistes. Henriette Walter a jugé la raison recevable. Ces recherches et discussions diplomatiques représentent un voyage au long cours : six ans d’un travail de samaritain pour boucler ces 564 pages ! « La botanique est beaucoup plus compliquée que la zoologie, observe Pierre Avenas, le nombre d’espèces est incroyablement plus élevé. »

Lire ces pages tient à la fois de l’incursion dans un cabinet de curiosités du 18e siècle et d’une promenade savante entre les langues européennes, le français mais aussi l’italien, l’espagnol, l’anglais et l’allemand. « Notre plaisir est d’épuiser le sujet » souligne Pierre Avenas en se référant à l’écrivain Georges Perec et aux livres à clés des pataphysiciens.
Faisons le test avec le hêtre. Son nom en français vient du vieux germanique, explique Henriette Walter ; il remonte au francique haistr. Cependant, pour désigner le hêtre adulte, on s’est référé au latin classique fagus d’où sont issus les noms de fou, fau ou fayard. Ainsi le lieu-dit Le Puy du Fou n’a rien à voir avec la folie mais signifie « la colline du hêtre ». Et nombre de patronymes en France conservent la trace du fagus latin, les Fayolle, Faye, Fayard, Fouet… Dans les langues germaniques, il existe une « remarquable similitude » entre les noms pour le hêtre et pour le livre (respectivement Buche et Buch en allemand). « Cette correspondance se comprend mieux si l’on se souvient que c’était sur du bois de hêtre que les premiers écrits ont été réalisés en Europe » rappellent les auteurs. Quant au mot français pour livre, il vient du latin liber qui désigne toujours le tissu végétal entourant le tronc de l’arbre (la partie souple de l’écorce). « Le meilleur liber est celui du hêtre, ajoute Pierre Avenas, la sève redescend par le liber et lui donne son élasticité. On écrivait dessus et on pouvait le rouler. Cette histoire permet de comprendre le terme « volume » qui vient de volvere (rouler) ». Incessants aller et retour entre la botanique et les langues où l’on apprend que les arbres ont permis de fabriquer les premiers livres en Europe !
« Dans la nature, il ne faut rien voir d’impossible, s’attendre à tout, et supposer que tout ce qui peut être, est ». (Buffon)
Si l’étymologie est pleine de surprises, la science de la classification aussi recèle de drôles de correspondances. Il est ainsi étonnant de voir le tilleul et le baobab classés dans la même famille, celle des malvacées. Dans la nature, disait Buffon, « il ne faut rien voir d’impossible, s’attendre à tout, et supposer que tout ce qui peut être, est ». Dans le cas de ces deux arbres, il s’agit d’une parenté génétique qui ne transparaît pas dans l’apparence extérieure, précise Pierre Avenas. Elle est établie grâce à la classification phylogénétique des végétaux publiée par Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader, la dernière parue. La logique des chapitres du livre s’appuie sur celle-ci et classe les arbres par familles (ou clades). Pour trouver des liens insoupçonnés entre les arbres, il faut lire un chapitre entier et se laisser entraîner par l’arbre directeur ou « emblématique ». Le ginkgo, par exemple, venu du fond des âges. Pierre Avenas affectionne la surprenante histoire de sa redécouverte au Japon, à la fin du 17e siècle, par le botaniste allemand Engelbert Kaempfer à proximité d’un temple. Des fossiles de cet arbre montrent qu’il est resté pratiquement inchangé depuis environ 150 millions d’années. Sa résistance aux virus et aux agents mutagènes est exceptionnelle. Plusieurs ginkgos ont survécu à l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima le 6 août 1945.
« Majestueuse », il n’y avait de meilleur qualificatif pour décrire cette histoire. Les arbres ne sont pas seulement « magnifiques ou admirables », ils sont « vraiment majestueux, grands, imposants » s’enthousiasme Henriette Walter. « On aurait pu dire aussi la très longue histoire des arbres » tente Pierre Avenas. Dans cette perspective, les conifères, les premiers arbres apparus sur la Terre à l’ère primaire, sont la référence obligée. Et on en revient à la majesté de l’arbre tutoyant le ciel, le séquoia. C’est actuellement un séquoia sempervirent, dans le Redwood National Park, aux Etats -Unis, qui détient le record mondial de hauteur avec ses 115, 55 mètres. Il se nomme Hyperion, le Titan de la mythologie qui a engendré le Soleil, la Lune et l’Aurore. « Dans nos ouvrages, nous partons toujours du plus petit au plus grand », souligne Henriette Walter, en l’occurrence « du modeste noisetier au séquoia géant », le sous-titre du livre. Elle aime raconter « l’histoire prodigieuse » du métis amérindien Sequoyah, fils d’une indienne cherokee et d’un blanc. Au début du 19e siècle, il invente un alphabet pour la langue cherokee, permettant ainsi de l’écrire, fait exceptionnel parmi les langues amérindiennes. Le nom du roi des arbres américains honore ce personnage hors du commun. « On a longtemps cru que les séquoias étaient les plus vieux arbres du monde avec plus de 2 000 ans d’âge, rappelle Pierre Avenas, puis on a découvert un ensemble de pins âgés de plus de 4 000 ans dans les Rocheuses et en 2008, un épicéa de plus de 9 000 ans, en Suède. Il serait le doyen. » Les conifères, « rois des forêts », sont bel et bien les arbres de tous les records !
En Europe, la majesté revient assurément au chêne, dont la couronne, formée de branches sinueuses, peut atteindre jusqu’à près de 40 mètres de diamètre. Le chêne est l’arbre par excellence : le nom pour signifier l’arbre en grec primitif, drus, s’est spécialisé pour nommer le chêne, explique Henriette Walter. Pline admire cet arbre symbole de puissance et de force et décrit « l’énormité des chênes rouvres de la forêt hercynienne » qui « dépasse toute merveille » en Germanie. Le même auteur raconte la fascination des druides pour le gui, extrêmement rare sur un chêne. « Ils regardent tout ce qui pousse sur ces arbres comme envoyé du ciel » écrit-il. Le chêne rouvre est l’arbre mythique des Gaulois tout comme le frêne celui des Scandinaves.
En latin classique, tous les noms d’arbres sont du genre féminin comme le nom arbor

Dans le monde des arbres, c’est cependant le genre masculin qui a fini par l’emporter dans les langues romanes. En latin classique, tous les noms d’arbres sont du genre féminin comme le nom arbor « arbre ». « La nature féminine de l’arbre viendrait du fait qu’il donne des fruits, par analogie avec la femelle qui portent des petits chez les animaux » suggère Henriette Walter. En grec ancien, les noms des arbres étaient aussi généralement au féminin. Le changement de genre intervient dès le bas latin et il sera systématique en français où les noms d’arbres passent au masculin. L’arbre devient synonyme de force et de vigueur, pourvoyeur de bois, matériau solide et résistant. Et en français, le nom arbre désigne aussi des objets tels que l’arbre de transmission, l’arbre à cames ou l’arbre d’hélice.
Parfois, il reste des doutes sur l’étymologie d’un nom, admettent les auteurs. C’est le cas du sassafras, issu de l’espagnol sasafrás dont l’origine est contestée. Sasafrás est-il emprunté à une langue d’Amérique du Sud ou dérivé du latin saxifraga ou encore résulte-t-il de la confusion entre le nom amérindien et le nom européen ? « L’étymologie n’est pas une science mais une discipline qui utilise beaucoup d’autres disciplines, souligne Henriette Walter, sans trace écrite, l’incertitude plane. » Alors, laissons filer la métaphore. « Sans doute , on lui a donné le nom qu’il porte (ndlr : le fromager) à cause que son bois est si mol qu’on peut le couper aussi aisément que du fromage. » Son fruit, le kapok, hélas ne se mange pas.
– Découvrir les chroniques chimiques de Pierre Avenas, ici.