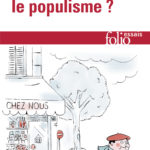Un siècle d’idées européennes par Jan-Werner Müller
Publié le 2 février 2019 par Sylvie Taussig
L’idée : proposer des synthèses claires des idées et des systèmes qui ont façonné le XXe siècle européen, et l’influencent encore.

![Jan-Werner Müller (Trad. de l'anglais , Difficile démocratie. Les idées politiques en Europe au 20e siècle. 1918-1989 (Alma Editeur, 2013 [2011]), 650 p., 27 € Date de parution : 7 novembre 2013. Jan-Werner Müller (Trad. de l'anglais , Difficile démocratie. Les idées politiques en Europe au 20e siècle. 1918-1989 (Alma Editeur, 2013 [2011]), 650 p., 27 € Date de parution : 7 novembre 2013.](https://www.lesinfluences.fr/wp-content/uploads/2019/02/png_democratiebig.png)
Le livre décrit des ruptures, dont la première et principale est la Première guerre mondiale. Auparavant, l’Europe connaissait une politique libérale, et la circulation des biens et des personnes était libre, dans le cadre d’un monde dominé par les formes anciennes – rois, nobles, aristocratie, empires. Sur les décombres de la Grande Guerre se fait jour un nouvel acteur de la politique, un acteur paradoxal dont ni les penseurs ni les politiques ne savent vraiment que faire et ne savent davantage qui il est : les masses. Les masses font irruption à la suite du massacre de masse, et elles doivent être pensées par rapport à la démocratie, soit gouvernement du peuple. Des expériences de démocratie totale sont tentées – et échouent (en Allemagne, par exemple). Libéralisme, marxisme, totalitarisme, nazisme se constituent par rapport aux masses, et c’est la prévalence de ces dernières qui justifie la place que Müller donne à Sorel, dont l’influence sur Carl Schmitt est bien connue ; il montre comment elle s’étend au-delà et le justifie, sa vie elle-même devenant exemplaire.
L’auteur de (Qu’est-ce que le populisme ? Gallimard 2018) travaille la question si actuelle du « peuple » d’un tout autre point de vue, en commençant son enquête par la pensée de Max Weber, laquelle donne le ton à son enquête. Si les idées politiques et les penseurs qui les formulent, à l’épreuve de l’histoire vivante, jouent un rôle si important dans le siècle, siècle des idéologies et des tentatives d’application de diverses théories politiques, qui se différencient par leur conception de la mobilisation politique du peuple et de sa relation avec le chef, c’est bien parce que surgissent ces masses, qu’il s’agit de capter ou de dompter, de mobiliser ou de faire advenir. 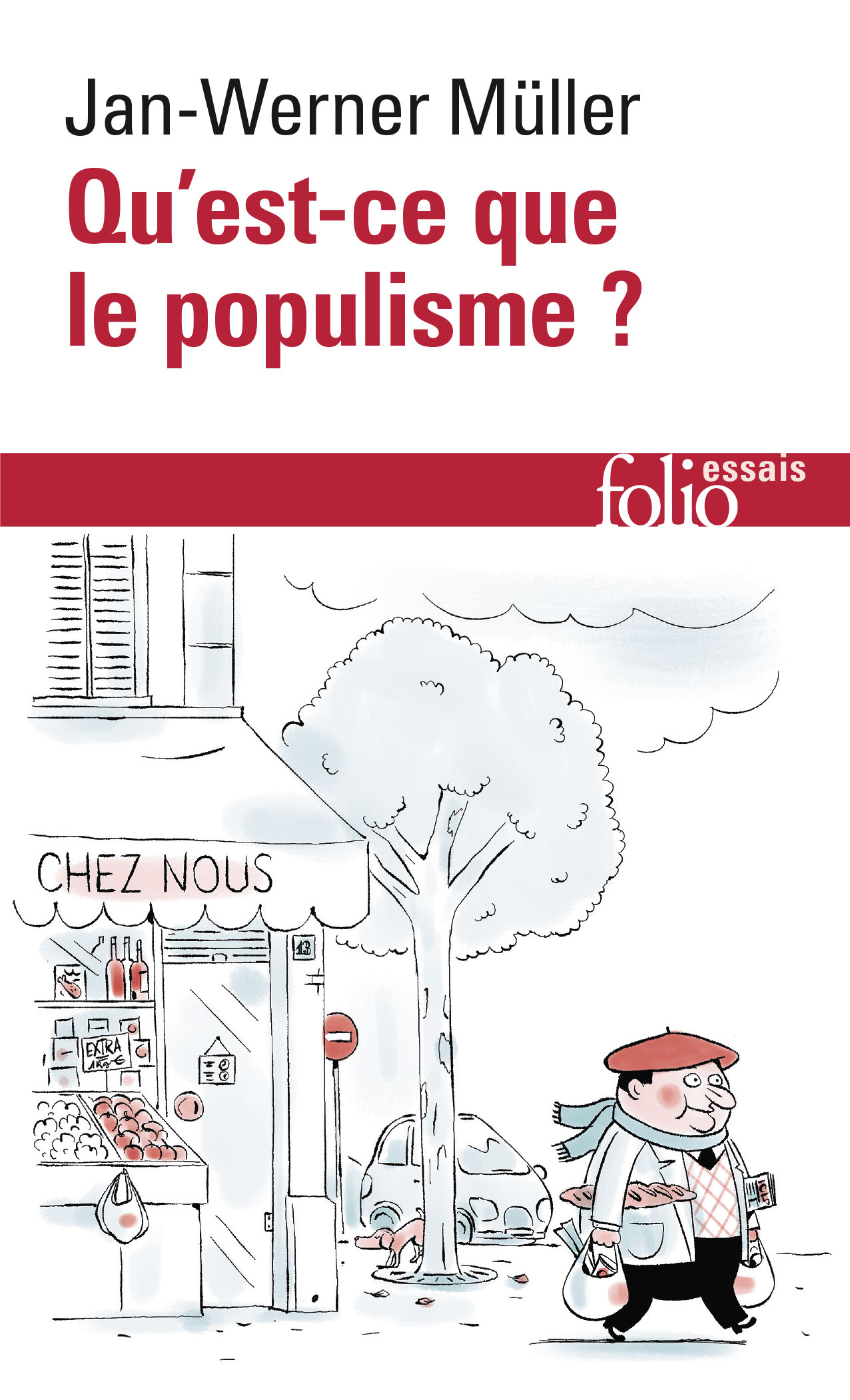 Pour l’auteur, il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour trouver le modèle d’une démocratie stabilisée, et ce sera une démocratie non totalement démocratique, dans la mesure où elle confère un rôle important aux cours constitutionnelles et où elle permet la réconciliation de deux forces qui paraissaient incompatibles, les églises chrétiennes d’une part et la démocratie de l’autre. Le grand moment de l’Europe est donc ici clairement désigné, sous les auspices du personnalisme, illustré, théorisé, encouragé par la figure de Jacques Maritain.
Pour l’auteur, il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour trouver le modèle d’une démocratie stabilisée, et ce sera une démocratie non totalement démocratique, dans la mesure où elle confère un rôle important aux cours constitutionnelles et où elle permet la réconciliation de deux forces qui paraissaient incompatibles, les églises chrétiennes d’une part et la démocratie de l’autre. Le grand moment de l’Europe est donc ici clairement désigné, sous les auspices du personnalisme, illustré, théorisé, encouragé par la figure de Jacques Maritain.
Selon Müller, le mai 68 que nous connaissons(pas celui de la répression tchèque) tisse un lien évident avec l’âge de la post-idéologie
La suite de l’histoire va voir la remise en cause de ces grands équilibres, avec la montée en force du « peuple » qui s’exprime particulièrement en mai 68, date que l’auteur explore longuement et d’une façon saisissante ; en effet, s’il raconte bien les événements parisiens et leurs penseurs, ainsi que leurs conséquences, par exemple sur le féminisme, et, dans la foulée, les événements analogues qui saisissent les démocraties occidentales, pour lui mai 68 est d’abord la révolution tchèque et sa répression, qui démontre l’échec radical de l’expérience socialiste. En face, le mai 68 que nous connaissons n’a aucune conséquence constitutionnelle ; l’événement est sociétal ; son lien avec l’âge de la post-idéologie est évident.
L’ouvrage ne va cependant pas si vite : avec une très grande sophistication, il passe en revue, sans que ce ne soit jamais un catalogue (certaines répétitions cependant font parfois penser à un rassemblement d’articles ; cependant les variations permettent aussi d’approfondir la compréhension), les penseurs du continent, de l’ensemble du continent, de la Suède au Portugal en passant par les pays d’Europe orientale, dont la Yougoslavie, pour montrer la pertinence de leur contribution eu égard au thème des masses. Nous avons donc des démocrates, mais aussi bien des penseurs du totalitarisme, du fascisme, du stalinisme, et l’auteur s’emploie à montrer les différences profondes entre ces expériences politiques, le plus souvent par rapport aux définitions de Weber – sur le charisme, sur la bureaucratie, sur la recherche d’une pureté idéologique ou non. Ce qui fait tout l’intérêt de ces théorisations, c’est qu’elles n’étaient pas produites dans une tour d’ivoire, mais bien au contact de la politique et de l’histoire réelles, par des auteurs plus ou moins proches de mouvements politiques. À cet égard, les développements sur Lukacs ou Bloch sont particulièrement intéressants, dans la mesure où les deux philosophes durent articuler l’exigence de liberté de pensée et l’enrôlement dans une idéologie et un parti.
Un éloge de cette démocratie chrétienne présentée comme l’artisan d’un apaisement des idées souvent meurtrières

Il est tout aussi impossible de citer tous les différents auteurs dont le portrait est ici fait : arbitrairement je retiendrai celui de Weber lui-même, ou encore de Guy Debord – l’expérience situationniste, dans son ambigüité, est très bien explorée ; ou bien de rappeler les expériences politiques qui permettent à l’auteur d’appuyer sa démonstration, comme celle du Karl Marx Hof à Vienne. Des pages très nourrissantes sont consacrées à la décolonisation et à la question de l’effacement de la violence par la violence, une question qui surgit tout autant aujourd’hui, dans le sillage de la pensée décoloniale. Les convictions politiques de l’auteur lui font verser les décolonisations entièrement à charge des politiques d’avant-guerre (et notamment des politiques de la race), et ce point est sans aucun doute contestable. La focalisation sur les idées politiques met de côté la réalité des rapports économiques et de domination, y compris dans les politiques nationales ; pour Müller le marxisme ne survit pas à la crise du marxisme (p. 198). La thèse, clairement affirmée, avec un luxe d’arguments et de raisonnements (passant par la description de la Turquie de M. Kemal ou celle des mouvements terroristes de la Bande à Baader aux Brigades rouges), se fonde sur de nombreux éléments, dont il faudra tenir compte pour toute réflexion à venir sur le devenir de l’Europe, à la fois de chacun des pays qu’elle englobe et de la construction européenne. De la démocratie, liée à une expérience historique spécifique, il montre la fragilité – et le prix.


![Jan-Werner Müller (Trad. de l'anglais , Difficile démocratie. Les idées politiques en Europe au 20e siècle. 1918-1989 (Alma Editeur, 2013 [2011]), 650 p., 27 € Date de parution : 7 novembre 2013.](https://www.lesinfluences.fr/wp-content/uploads/2019/02/png_democratiebig-150x150.png)